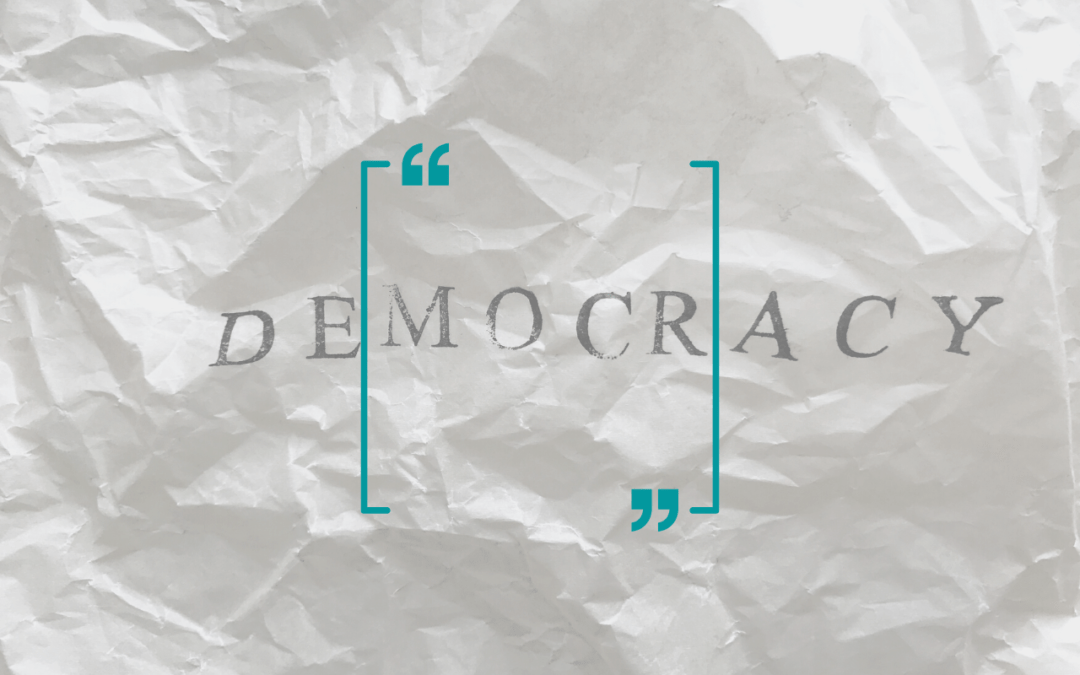Souveraineté et démocratie : voilà, si l’on peut dire, une équation à deux inconnues. Ou plutôt à deux « trop connues ». Car, si nous nous plaignons d’une perte de souveraineté et d’un manque de démocratie, si nous craignons d’être dépossédés de l’une et de l’autre, c’est que nous pensons savoir ce qu’est la démocratie et ce qu’est la souveraineté.
Pourtant la démocratie répond à des définitions multiples. On ne saurait la réduire à un certain type de régime politique (la souveraineté populaire), à l’organisation institutionnelle de celui-ci (la démocratie représentative). La démocratie désigne un certain type de société (la société démocratique) c’est-à-dire une manière de vivre qu’on peut caractériser comme éthos démocratique. On observe depuis longtemps déjà des nouvelles expériences démocratiques axées sur un paradigme communicationnel et pluraliste, et même ce qu’on peut appeler une « démocratisation de la démocratie ». La démocratie est partout en débat avec elle-même, au-delà et partiellement contre les formes institutionnelles de la démocratie (représentative), avec la promotion de ce qu’il est convenu de nommer la « démocratie participative »[1]. Cette démocratisation de la démocratie s’exprime à travers la recherche dans la société civile de la parole et de la compétence de non-professionnels de la politique pour ramener à la vérité de la politique (le bien commun qui appartient à tous), la renaissance de l’action militante hors des partis politiques, c’est-à-dire une espèce de polycentrisme militant qui fait sortir du modèle jusque-là dominant (le parti politique au centre, et à la périphérie, le syndicat, l’association). Ce qui se traduit par-là, c’est la conscience que désormais plus aucun parti ne peut faire la synthèse des idées et de la discussion sur les questions politiques nouvelles par le simple jeu de son débat interne (de là aussi l’efflorescence des « Think Tank »). Toute cette nouvelle disposition politique est à mettre en perspective avec le développement croissant de ce l’historien P. Rosanvallon nomme la « contre démocratie »[2]. Les partis tendent à ne plus être le canal principal de la communication entre les citoyens et les dirigeants politiques : un équilibre se cherche entre la démocratie représentative (électorale) et la démocratie participative. La souveraineté du peuple se manifeste de plus en plus comme puissance de refus qui impose au « peuple électeur du contrat social » un peuple surveillant, un peuple-veto, ou un peuple juge (Rosanvallon). Ainsi si la démocratie d’élection s’est érodée, la démocratie d’expression, d’implication, d’intervention s’est au contraire affermie – ce qui suffit à faire justice du mythe du citoyen passif. On assiste à l’avènement de formes non conventionnelles de démocratie, à une politique protestataire (protest politics), à une citoyenneté civile jusqu’à la désobéissance, et dans des formes radicalisées et assumées de violence — ce qui conduit à parler de « politique non gouvernementale » de « politique des gouvernés », mais toujours à l’ombre d’une indétermination sans doute insurmontable de la notion de « peuple »[3].
Peut-être la caractéristique de la démocratie au-delà de sa fragilité (de la démocratie à la démagogie à tyrannie, il n’y a parfois qu’un pas comme le suppose déjà Platon dans la République), c’est son indétermination qui la rend « agnostique »[4], « anarchique »[5], ou indéfinissable. Ainsi pour Cl. Lefort, la radicale étrangeté de la démocratie est d’assigner le pouvoir à un « lieu vide » et inappropriable.
« La société démocratique moderne m’apparaît, de fait, comme cette société où le pouvoir, la loi, la connaissance se trouvent mis à l’épreuve d’une indétermination radicale, société devenue théâtre d’une aventure immaîtrisable, telle que ce qui se voit institué n’est jamais établi, le connu reste miné par l’inconnu, le présent s’avère innommable, couvrant des temps sociaux multiples décalés les uns par rapport aux autres dans la simultanéité — ou bien sommables dans la seule fiction de l’avenir ; une aventure telle que la quête de l’identité ne se défait pas de l’expérience de la division. Il s’agit là par excellence de la société historique »[6].
Finalement, la démocratie est et continue d’être un scandale puisqu’elle consiste, selon J. Rancière, sur le modèle de la démocratie grecque par tirage au sort, à confier le pouvoir à quiconque ou à n’importe qui, c’est-à-dire à celui qui n’a précisément aucun titre à gouverner.
« Le scandale est là : un scandale pour les gens de bien qui ne peuvent admettre que leur naissance, leur ancienneté ou leur science ait à s’incliner devant la loi du sort ; un scandale aussi pour les hommes de Dieu qui veulent bien que nous soyons démocrates, à condition que nous reconnaissions avoir dû tuer un père ou un pasteur, et être donc infiniment coupables, en dette inexpiable à l’égard de ce père. Or le “septième titre” nous montre qu’il n’est besoin, pour rompre avec le pouvoir de la filiation, d’aucun sacrifice ou sacrilège. Il suffit d’un coup de dés. Le scandale est simplement celui-ci : parmi les titres à gouverner, il y en a un qui brise la chaîne, un titre qui se réfute lui-même : le septième titre est l’absence de titre. Là est le trouble le plus profond signifié par le mot démocratie. Pas question ici de gros animal rugissant, d’âne fier ou d’individu guidé par son bon plaisir. Il apparaît clairement que ces images sont des manières de cacher le fond du problème. La démocratie n’est pas le bon plaisir des enfants, des esclaves ou des animaux. Elle est le bon plaisir du dieu, celui du hasard, soit d’une nature qui se ruine elle-même comme principe de légitimité. (…) Le scandale est celui d’un titre à gouverner entièrement disjoint de toute analogie avec ceux qui ordonnent les relations sociales, de toute analogie entre la convention humaine et l’ordre de la nature. C’est celui d’une supériorité fondée sur aucun autre principe que l’absence même de supériorité.
Démocratie veut dire d’abord cela : un “gouvernement” anarchique, fondée sur rien d’autre que l’absence de titre à gouverner »[7].
A propos de la démocratie donc, l’erreur est de croire pouvoir la définir autour d’une forme fixe.
Concernant la souveraineté, l’erreur serait plutôt de croire qu’elle est exclusivement politique. Or les NBIC, le développement exponentiel de l’IA imposent une nouvelle configuration à la souveraineté par les risques inédits de domination, de vassalité des individus et des nations.
Que se passe-t-il donc pour la démocratie quand la souveraineté devient « technologique » ? Une maîtrise démocratique de la souveraineté technologique est-elle possible ? Ces deux questions qui figurent parmi les plus grands défis de l’époque obligent, en fait, à penser ensemble la souveraineté, la démocratie et l’État, pour autant que l’État se définit par la puissance souveraine ou que la souveraineté lui est historiquement rattachée.
Souveraineté et démocratie ne sont pas sans lien, outre le fait de nous être familières et donc faussement connues.
D’abord elles se présentent également comme des biens désirables : la démocratie passe pour le moins mauvais régime politique, et la souveraineté est l’assurance d’un exercice entier de sa propre liberté. Il est préférable de vivre en démocratie plutôt qu’en régime dictatorial, hier en système totalitaire, et aujourd’hui en démocratie libérale plutôt qu’en démocratie dite « illibérale ». Il est aussi souhaitable de pouvoir maîtriser soi-même son destin, de ne pas dépendre d’un pouvoir extérieur, c’est-à-dire d’être souverain. La démocratie et la souveraineté ont chacune rapport à la liberté.
Ensuite, la démocratie se définit elle-même comme une certaine souveraineté : le pouvoir souverain du peuple. Le peuple est le principe de légitimité de la puissance du pouvoir étatique (au nom de). On rappellera que la souveraineté, depuis le XVIIe (Bodin), passe pour être l’attribut de l’État, ou plutôt qu’elle est l’essence de l’État moderne qui exerce sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance dans l’ordre international où il n’est tenu que par ses engagements (souveraineté externe). Voici deux définitions de l’État et de la souveraineté qui font apparaître leur lien consubstantiel[8] :
[État]: « Organisation politique et juridique de la nation qu’elle personnifie. L’État est une personne morale caractérisée par la détention de prérogatives de puissance publique et par sa soumission aux sujétions correspondantes. Sujet de droit international public caractérisé par un territoire, une population et l’existence d’un ordre juridique souverain (souveraineté de l’État) » ;
[Souveraineté]: « Signifie négativement, l’absence de toute dépendance extérieure et de tout empêchement intérieur. Positivement, désigne le caractère suprême de la puissance étatique, et cette puissance elle-même, c’est-à-dire les pouvoirs effectifs compris dans la puissance de l’État. La souveraineté emporte donc à la fois l’indépendance dans l’ordre international (souveraineté de l’État), et le contenu de ce pouvoir. Elle est l’apanage de l’État, à l’opposition d’une organisation internationale (Union européenne) qui ne peut bénéficier que de transferts de compétences consentis par les États membres »
Or, quand le peuple, au moins par ses représentants, fait la loi, l’État est démocratique. La toute-puissance qui constitue la souveraineté consiste d’une part à faire la loi et à dire le droit — pouvoir qui l’emporte sur tous les autres —, et d’autre part, à pouvoir revendiquer sans résistance le monopole de la violence légitime.
Mais aujourd’hui, les rapports entre souveraineté et démocratie sont mal assurés. L’idéal démocratique n’est pas en cause. Pourtant la démocratie traverse bien une crise ou des crises. On condamne le mépris des élites pour le peuple, le déni démocratique dans la manière de gouverner, etc. Dans ce contexte qui reflète à sa façon la complexité du monde, les gouvernements peuvent céder à la tentation technocratique. Inversement, pour redonner à la démocratie toute sa vitalité, les oppositions en appellent au peuple, plébiscitent le recours au référendum, et peuvent céder à la tentation populiste. La démocratie est comme prise en otage par cette opposition entre la technocratie (qui accompagne ou accomplit le renouveau libéral (néolibéralisme) du capitalisme[9]) et le populisme (qui accompagne ou accomplit la demande d’un renouveau de la démocratie).
C’est aussi dans ce contexte agité, qu’on voit le retour en force, après une certaine éclipse, de l’appel à la souveraineté, dans tous les domaines : souveraineté alimentaire, énergétique, stratégique, sanitaire, numérique. On veut donc réindustrialiser, relocaliser, promouvoir le circuit court, encourager l’excellence « made in X », etc. On redécouvre que l’innovation, l’esprit de conquête scientifique, technologique et industriel est la condition de la prospérité, de la liberté et de la sécurité des nations.
Mais comment interpréter cet assaut d’exigence de souveraineté ? Si l’on prend, par exemple, le cas de la « souveraineté numérique », celle-ci peut désigner :
(1) la souveraineté « sur » le numérique : le numérique est un champ qui doit être limité, contrôlé. La question est alors : par qui et pourquoi ? ;
(2) la souveraineté qui est numérique, comme on parle précisément de souveraineté populaire ou nationale qui veut dire souveraineté exercée par le peuple ou la nation : ici il serait question d’une manifestation numérique de la souveraineté. Il s’agirait alors de savoir comment la souveraineté démocratique peut se manifester par le numérique ;
(3) le numérique souverain. Cette fois c’est le numérique qui s’empare de la souveraineté : le numérique est le « sujet » complet de la souveraineté.
On assiste donc peut-être à une sorte de « gigantomachie » qui oppose la souveraineté légitime du peuple (la souveraineté comme puissance politique) à la puissance technologique qui modèle toutes les vies (la puissance comme souveraineté technique). Ou, à tout le moins, on constate une déconnexion entre État et souveraineté qui n’est pas sans effets sur la démocratie. Le numérique dépossède-t-il l’État de sa souveraineté au profit de sujets de droit privé (multinationales) ? Mais dans un raisonnement strictement libéral, il s’agirait moins d’une dépossession que du développement extra-étatique d’activités très concurrentielles à forte valeur ajoutée ? Ou bien, la dépossession affecte-t-elle seulement l’État qui héberge les entreprises du numérique, avec tous les risques de sécurité nationale que cette implantation entraîne ? La question de la souveraineté numérique est donc indissociablement technologique et juridique.
Les idées qui pourraient émerger de ces quelques rappels et considérations, pourraient être celles-ci :
- l’articulation entre démocratie et souveraineté passe encore par l’État : l’État est, en effet, un acteur de souveraineté et un acteur susceptible de maintenir les valeurs fondatrices de la démocratie ;
- mais l’État d’une part ne peut pas être souverain numériquement comme il l’est politiquement ;
- et, d’autre part, l’État n’est pas le seul acteur politique de la souveraineté publique— de fait la souveraineté numérique a pour cadre la communauté européenne contre des (toutes-)puissances en rivalité « mimétique » ;
- donc il faut redéfinir la souveraineté et ses finalités ;
- Par souveraineté numérique, on peut entendre un « plurivers » numérique, c’est-à-dire un univers numérique où cohabitent plusieurs souverains et non une situation de monopole (« cosmo-numérisme »). Mais là encore, se pose le problème du rapport possible entre ces souverains numériques et les États (souverains politiques), l’asymétrie entre le dynamisme de l’innovation et l’inertie législative. Les États ont-ils les moyens, même sous l’égide d’une législation communautaire, de réguler le numérique pour préserver la liberté et l’égalité qui sont les piliers de la démocratie ?
Auteur :
Laurent Cournarie – Professeur de philosophie – Chaire Supérieure – Première supérieure – www.laurentcournarie.com
[1] Cet avènement est évidemment ambigu : s’agit-il d’un retour du politique, d’un regain du désir politique, d’une renaissance démocratique, d’une re-légitimation démocratique, ou d’un événement qui n’annule pas la défiance profonde des citoyens à l’égard des élus, l’incrédulité sur le pouvoir ou la puissance de la politique à organiser la vie en société et qui accentue, paradoxalement, le travers de la personnalisation et de la professionnalisation du jeu politique ?
[2] Voir P. Rosanvalon Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Folio Gallimard, 2001 ; La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2012 ; Le bon gouvernement, Paris, Le Seuil, 2015.
[3] Peut-être le peuple n’existe-t-il pas ou est-il une fiction s’il répond à plusieurs définitions ou descriptions (peuple civique, peuple social, peuple ethnique…).
[4] Ch. Mouffe, Le politique et ses enjeux, Paris, La Découverte, 1994.
[5] J. Rancière, La mésentente, Paris, Galilée, 1995.
[6] Cl. Lefort, L’invention démocratique, Paris, Livre de Poche, 1990, p. 182.
[7] J. Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.
[8] P. Avril et J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 2003, cité par P.-Y. Quiviger, « Une approche philosophique du concept émergent de souveraineté numérique ».
[9] Voir B. Stiegler, « Il faut s’adapter » : Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019.
Pour en savoir plus sur nos commissions :
Pour lire d’autres articles :