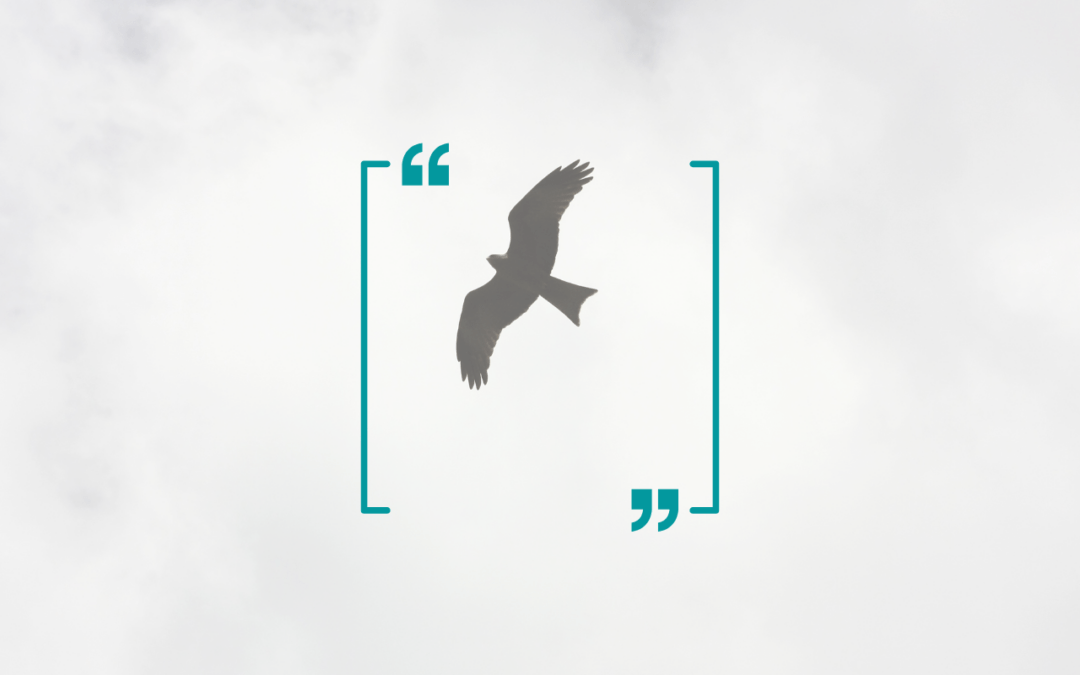Une cause extérieure peut-elle restreindre notre liberté ?
Nous avons vu précédemment que notre déterminisme nous positionne sur une trajectoire dont il est difficile de se sortir, sauf à choisir de s’y extraire, grâce à notre logos, et de le faire au prix d’une volonté et d’une énergie considérable.
Petite question : pourquoi sortez-vous votre téléphone portable de votre sac dès que vous avez un moment et prenez un air très occupé en le manipulant ? En avez-vous conscience ? Quel effort auriez-vous à fournir pour vous en affranchir ?
En réalité, votre environnement vous a façonné, créant un nouveau déterminisme « acquis ». Vous avez accepté cette contrainte sans vous en rendre compte, parfois même au prix d’une souffrance inconsciente. Sommes-nous libres en telle situation ?
N’y-a-t-il de vraie liberté que si l’on agit sans contrainte extérieure ? Pour certains philosophes, oui. Vison absolue ? Utopie ?
Avec l’absolu tout est permis puisqu’on ne tient pas compte du réel…
Il n’en demeure pas moins que nous sommes aussi nos propres contraintes.
Prenons un exemple : la volonté est pour certains philosophes le siège de la liberté. Kant écarte cette notion dans la mesure ou ceci relève de la psychologie, de l’empirique. Kant cherche l’absolu, l’inconditionnel. Cet absolu est exprimé chez lui par un concept : l’impératif catégorique. On ne transige pas avec la morale, ni avec l’absolu. Il devient alors possible de priver de liberté au nom de l’absolu. Raccourci bien sûr. Pourtant… N’est-ce pas inquiétant ?
Or les humains sont des êtres vivants. On l’a déjà évoqué, le vivant interagit avec son environnement. Cette interaction nous modifie et nous oriente. Nous sommes donc sous contrainte de notre environnement.
Qu’il est difficile d’être fondamentalement libres, embarqués inconsciemment sur une trajectoire dont l’effet relève d’une causalité de facteurs multiples interagissant entre eux. Pour mieux l’imager, on pourrait dire que la nature des agents, des interactions, produisent un ensemble de forces faisant de notre trajectoire déterministe une sorte de résultante.
Ainsi, sommes-nous soumis à un champ de pression orientant nos trajectoires de vies ?
Pour autant nous sommes libres d’être réactifs ou pro-actifs. On l’a vu, le réactif est moins libre que le pro-actif car ce dernier utilise son « logos » afin d’être aux commandes de sa réaction. Le réactif laisse ses impulsions le dominer. Voyez André Comte Sponville dire avec Spinoza qu’il faut se libérer de ses pulsions, des pensées qui nous harcellent ; de même que les Bouddhistes pratiquent la méditation à cette fin.
Pour Sartre on a toujours le choix de la liberté. Quel choix ? Ce que l’on vient de voir montre les limites de ce choix.
Ainsi, le pro-actif s’interroge sur les possibles avant de choisir.
Le champ des possibles est-il infini ?
J’utilise ce raisonnement à des fins réflexives, mais pour Sartre le choix ne serait-il pas au fond assez binaire : soumission ou révolte ? Exprimé ainsi, on est dans une tout autre nature de débat.
Il est aussi des causes extérieures qui confinent à la tyrannie. De la réglementation excessive d’un état à la dictature.
Nous avons ainsi évoqué ce que peut représenter la liberté au sens individuel ; au sens intrinsèque de ce que peut espérer un humain ; et constaté les limites de notre liberté. Puis l’impact de notre environnement.
Nous aborderons dans les chapitres suivants les aspects sociologiques. Mais traitées ex abrupto et décorrélées des conditions de libertés intrinsèque de l’individu, c’est parler du tout sans considérer l’existence des parties.
Passons maintenant au fonctionnement collectif et comment se justifie toute forme de régulation ou réglementation.
Auteur :
Luc Marta de Andrade – Président du Think Tank
Pour en savoir plus sur la commission Economie et la rejoindre :
Pour lire d’autres articles :