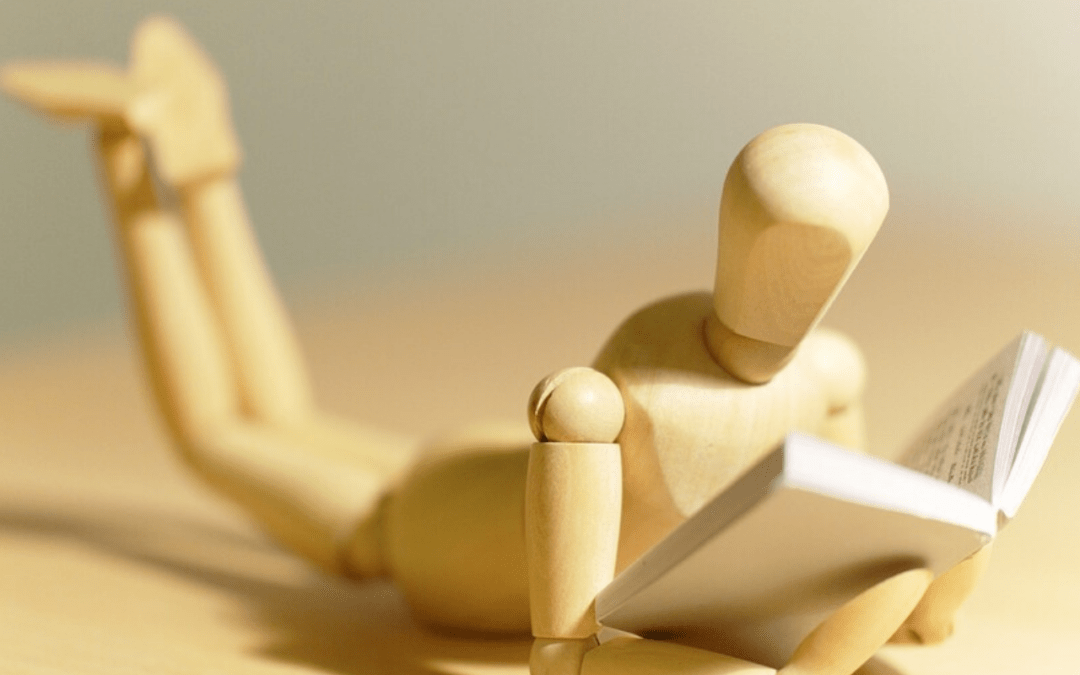L’éthique donne lieu aujourd’hui à trois types d’investigation[1] : la méta-éthique, l’éthique normative et l’éthique appliquée.
L’éthique normative et l’éthique appliquée s’intéressent à ce qu’il faut faire ou ce qu’il serait préférable de faire. Elle traite du devoir en général, tandis que l’éthique appliquée aborde ce qu’il faut faire dans un champ particulier[2]. L’une comme l’autre s’appliquent à des problèmes moraux de premier ordre (que doit-on faire ?). Les questions d’éthique normative sont par exemple :
- qu’est-ce qu’une société juste ?
- Quels sont les droits fondamentaux des êtres humains ?
- Quels sont les biens les plus importants dans la vie ?
- Qu’est-ce qu’une vie accomplie ?
— et de manière plus particulière :
- a) La justice sociale est-elle compatible avec l’inégalité ?
- A-t-on l’obligation morale d’accueillir tous les réfugiés et tous les migrants ?
- Peut-on justifier moralement l’existence de frontières ?
- Y a-t-il des guerres moralement justes ?
L’éthique appliquée est une branche de l’éthique qui s’est développée depuis les années 60 à partir des bouleversements sociaux, politiques et technologiques : décolonisation, mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis, révolution sexuelle, guerre du Vietnam, course aux armements nucléaires, mais aussi premier respirateur artificiel, première transplantation cardiaque, etc. Les progrès technologiques impliquent un renouvellement du questionnement éthique : avant le premier respirateur artificiel, la question d’acharnement thérapeutique ne se pose pas. Ainsi de nouvelles questions éthiques émergent, comme par exemple :
- à partir de quand un acte médical devient-il de l’acharnement thérapeutique ?
- a-t-on le devoir de donner ses organes sains après sa mort ?
- l’Etat devrait-il avoir le droit de les prélever automatiquement ?
Ainsi ces questions nouvelles, notamment dans le domaine biomédical — et désormais aussi en IA — ont suscité et suscitent des débats auxquels participent les philosophes. Ont vu le jour des comités d’éthique, des institutions (Kennedy Institute, Hastings Center…). Ainsi l’éthique appliquée est apparue progressivement dans trois domaines privilégiés : l’éthique biomédicale, l’éthique des affaires, l’éthique des soins.
Mais on peut prendre du recul par rapport à ces problèmes de premier ordre. La méta-éthique part de ce présupposé : avant de pouvoir agir moralement (et pour pouvoir le faire), il est requis de savoir comment fonctionnent nos concepts moraux. Autrement dit, il s’agit, conformément au tournant linguistique de la philosophie contemporaine, d’analyser la grammaire de nos concepts moraux. Ainsi la morale a trait au bien, ou encore, un énoncé moral est un énoncé qui contient le prédicat “bon“ : “il est bon de faire A pour obtenir B“, ou “X a été bon (en soi ou vis-à-vis de Y) en faisant A (par exemple en pardonnant)“. Mais qu’est-ce qui distingue l’usage moral du prédicat “bon“ ? Dans le premier énoncé, “bon“ a une signification descriptive parce qu’on rapporte un fait à un autre, tandis que dans le second il exprime une évaluation, et c’est pourquoi nous lui attribuons une connotation morale. Donc le problème est de savoir ce qui distingue un énoncé moral d’un autre. La philosophie met entre parenthèses l’action elle-même pour s’intéresser à l’autonomie d’une connaissance morale (d’où le préfixe « méta ») en la distinguant d’autres connaissances (scientifique, théologique, politique…), en délimitant l’éthique par rapport à d’autres champs du savoir humain. Relèvent de la méta-éthique les questions suivantes :
– qu’est-ce qui justifie de considérer certaines réponses éthiques comme meilleures que d’autres ?
– d’où vient que nous nous posions des questions morales ?
– qu’est-ce qui fait qu’une question/une attitude est morale ?
Autrement dit, la méta-éthique traite du phénomène moral en général, de son autonomie et de sa légitimité.
La méta-éthique donne lieu à quatre thèses principales sur la validité des jugements moraux : le réalisme, l’émotivisme (ou le subjectivisme), le rationalisme ou le relativisme.
Selon le réalisme, les propriétés morales sont aussi objectives que les propriétés physiques. Il est possible de saisir les unes comme les autres par intuition. Il n’y aurait pas de différence entre les prédicats “bon“ et “vert“. Aussi pourrait-on établir la vérité des jugements moraux. Par exemple, on pourrait prouver que commettre un vol, un adultère… est un mal. C’est une position objectiviste et cognitiviste.
Au contraire, l’émotivisme considère que les jugements moraux ne représentent pas des propriétés objectives mais expriment des sentiments d’approbation (louange) ou de désapprobation (blâme) devant une action ou un comportement. Un jugement moral est un jugement de valeur et non un jugement de fait et ne décrit que l’émotion du sujet qui juge. C’est une position subjectiviste et anti-cognitiviste.
Le rationalisme est une position qui partage avec l’émotivisme l’idée que les jugements moraux ne correspondent à rien dans la réalité extérieure. Mais ils traduisent des prescriptions dictées par la raison aussi nécessaire que les axiomes mathématiques. Même s’ils sont subjectifs, les jugements moraux sont universels puisque tous les hommes partagent la même raison[3].
Enfin le relativisme est la position la plus commune désormais : tous les jugements moraux dépendent des normes de la société à laquelle on appartient. Donc il est strictement impossible d’établir la valeur de vérité d’un jugement moral. Un jugement moral est une opinion relative à une époque ou à une communauté. Aucun n’est plus vrai qu’un autre. L’anthropophagie n’est-elle pas immorale ? Non, car comme disait déjà Montaigne, est barbare ce qui n’est pas de notre usage. Et si elle est pour nous immorale, elle ne l’est pas plus que l’ « anthropémie »[4] (de émein, vomir) pour eux. Et selon le même raisonnement, si l’on est conséquent, on ne dira pas : l’esclavage est immoral, mais légitime hier, il ne l’est plus aujourd’hui. L’esclavage serait encore considéré comme moral s’il était partagé par la majorité des membres de la société moderne, mais ce n’est plus le cas : il ne répond plus à nos croyances et à nos normes éthiques. Pour la même raison, il n’est possible de juger immorale l’institution antique de l’esclavage : autres temps, autres mœurs, autres jugements moraux. Cette position récuse évidemment toute hypothèse d’un progrès moral : nous ne sommes pas meilleurs que les Grecs et les Romains. Les sciences humaines ont conforté le relativisme en en faisant la “vérité“ indépassable de l’anthropologie[5].
Reste la difficulté liminaire. Quelle est la fonction et quel est le statut de la philosophie morale par rapport à la morale ? Nombreux sont les philosophes à avoir dénoncé l’inutilité des livres de morale. Plusieurs arguments sont récurrents :
1/ l’action ne souffre pas de délai : il faut vivre et agir et, en attendant de pouvoir déterminer les principes vrais de la morale, se contenter des préceptes d’une morale par provision. C’est pourquoi ces préceptes ne se donnent pas comme des devoirs universels mais comme des règles de conduite à usage personnel[6] ;
2/ la morale concerne l’action et non le discours. Or l’expérience montre que celui qui parle le plus de morale est parfois celui qui l’applique le moins. La vraie morale se moque du discours sur la morale. Le parallélisme avec la rhétorique dans la pensée de Pascal — « la vraie éloquence se moque de l’éloquence » — suggère, comme le remarque Eric Blondel, « que la morale se gorge de belles paroles »[7] : la fausse morale se pare toujours du beau discours sur les vertus à avoir, sur les valeurs à défendre. La théorie morale est moraliste et le moralisme est l’hommage que l’hypocrisie rend à la vertu, une tartufferie ;
3/ la morale est toujours simple. Or le discours théorique brouille les évidences du cœur, le sentiment du juste et de l’injuste. La morale précède dans son évidence la philosophie de la morale. Rousseau le dira : il n’est pas besoin d’être savant pour être moral, d’être philosophe pour être un honnête homme[8]. S’il fallait être philosophe pour être moral, la vertu serait le prix du savoir et la moralité le privilège de quelques-uns. Mais à cette injustice viendrait s’ajouter le risque de l’incertitude. Quelle doctrine suivre, quelle opinion embrasser ? La philosophie morale rend la morale vacillante. Prétendre fonder la morale est le plus sûr moyen de ne jamais être moral[9].
Mais en même temps, les philosophes n’ont cessé de réfléchir à la morale et de soumettre la réflexion morale à des principes, sinon pour étayer la morale, du moins pour juger l’action. Et c’est d’ailleurs ce théoricisme que la philosophie peut revendiquer pour se démarquer de la mode contemporaine de l’éthique[10]. La philosophie a sans doute renoncé à dire comment vivre, comment agir, puisque nul ne peut plus prétendre avoir le monopole de la réflexion éthique. Mais elle prétend dire comment penser l’action avec les concepts les plus appropriés pour poser les questions morales dans les termes les plus précis. La philosophie s’empare des croyances ordinaires pour les clarifier, les ordonner par un travail conceptuel. Mais cette théorisation de la vie morale est-elle possible ?
Un courant (non dominant) de la philosophie (plutôt anglosaxonne), inspiré par Wittgenstein[11] insiste sur le primat de la pratique ou de la description en philosophie morale. Ils contestent la subordination de la réflexion éthique à la question des principes ou du fondement, au problème de la justification des conduites, comme s’il allait de soi que l’éthique doive être plutôt prescriptive que descriptive, plutôt législative qu’anthropologique. Ce n’est pas la morale ou même la philosophie morale qui est relativisée mais l’idée de théorie morale. Le réalisme est alors à chercher non dans une objectivité construite théoriquement (des principes qui systématisent nos jugements moraux en leur apportent une justification rationnelle) mais dans ce que “nous” faisons d’ordinaire, dans nos pratiques et dans façons habituelles de dire ce qu’une règle requiert. Il s’agirait de reconnaître que notre vie morale est assez éloignée des concepts privilégiés par la philosophie morale (les concepts « minces » selon Williams[12]) de devoir, obligation, rectitude, bien, juste) alors que sont négligées la lâcheté, la douceur (gentleness), la générosité ou l’amabilité, etc. — ce que Williams nomme les concepts « épais ». Notre vie morale concrète n’épouse pas spontanément les oppositions que la théorie dresse pour elle (bien/mal, droit/tort, rationnel/irrationnel…).
« Il n’y a personne qui ne convienne que tous les hommes sont capables de connaître la vérité ; et les philosophes mêmes les moins éclairés, demeurent d’accord que l’homme participe à une certaine Raison qu’ils ne déterminent pas. C’est pourquoi ils le définissent animal RATIONIS particeps : car il n’y a personne qui ne sache du moins confusément que la différence essentielle de l’homme consiste dans l’union nécessaire qu’il a avec la Raison universelle, quoiqu’on ne sache pas ordinairement quel est celui qui renferme cette Raison, et qu’on se mette fort peu en peine de le découvrir. Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4, et qu’il faut préférer son ami à son chien; et je suis certain qu’il n’y a point d’homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or je ne vois point ces vérités dans l’esprit des autres : comme les autres ne les voient point dans le mien. Il est donc nécessaire qu’il y ait une Raison universelle qui m’éclaire, et tout ce qui il y d’intelligences. Car si la raison que je consulte, n’était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la Raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes, est une Raison universelle. Je dis quand nous rentrons dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné. Lorsqu’un homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a des raisons, mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui dans le fond ne sont pas raisonnables, parce qu’elles ne sont pas conformes à la souveraine Raison, ou à la Raison universelle que tous les hommes consultent. » (Malebranche, De la Recherche de la vérité , Xè Eclaircissement)
L’exemple moral est mis exactement sur le même plan que l’argument mathématique. Il introduit l’idée d’ordre : la raison est la faculté de connaître l’ordre, les lois universelles de l’ordre. Or selon ces lois, il ne sera jamais vrai qu’il faille préférer son chien à son ami, comme il est vrai nécessairement et de toute éternité que 2 x 2 = 4.
Laurent Cournarie
Vous pouvez retrouver la suite ainsi que l’intégralité de cet article en cliquant sur ce lien : la morale et l’éthique partie 3